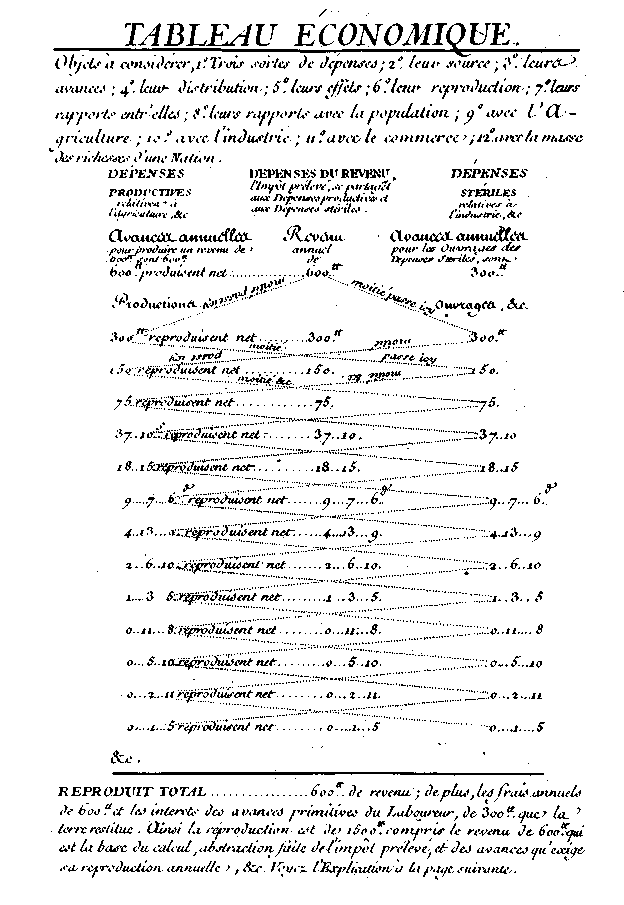
FRANÇOIS QUESNAY (1694-1774)
JUIN 1766
ANALYSE DE LA FORMULE
ARITHMÉTIQUE
DU TABLEAU ÉCONOMIQUE
DE LA DISTRIBUTION DES DÉPENSES ANNUELLES
D'UNE NATION AGRICOLE
[Le texte qui suit est celui de l'édition de Physiocratie, ou Constitution naturelle du Gouvernement économique d'un royaume agricole, publié en 1768 par Dupont de Nemours sous l'adresse de Leyde.]
Lorsque l'agriculture prospère, tous les autres arts fleurissent avec elle, mais quand on abandonne la culture, par quelque cause que ce soit, tous les autres travaux, tant sur terre que sur mer, s'anéantissent en même temps.
SOCRATE dans Xénophon.
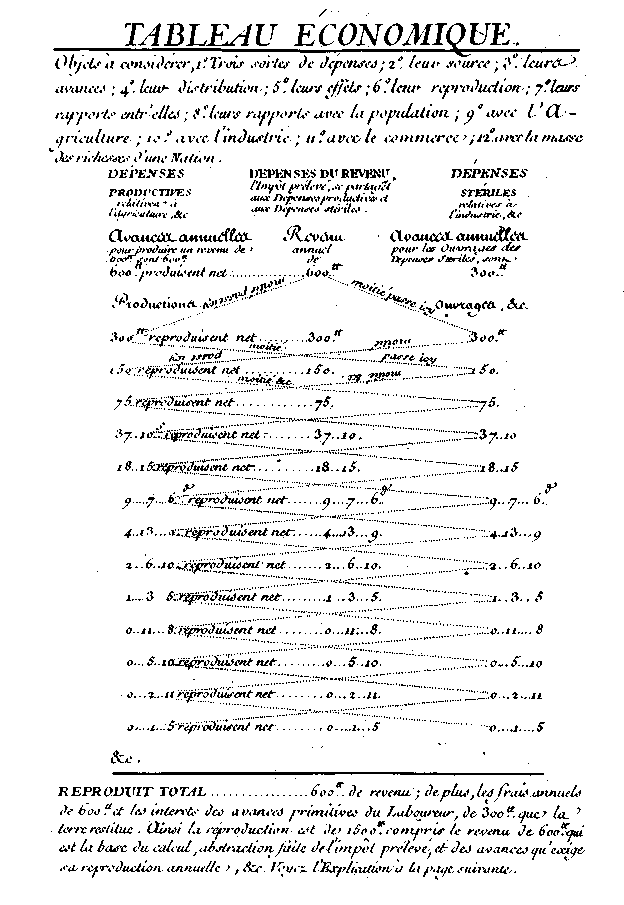
LA nation est réduite à trois classes de citoyens : la classe productive, la classe des propriétaires et la classe stérile.
La classe productive est celle qui fait renaître par la culture du territoire les richesses annuelles de la nation, qui fait les avances des dépenses des travaux de l'agriculture, et qui paye annuellement les revenus des propriétaires des terres. On renferme dans la dépendance de cette classe tous les travaux et toutes les dépenses qui s'y font jusqu'à la vente des productions à la première main, c'est par cette vente qu'on connaît la valeur de la reproduction annuelle des richesses de la nation.
La classe des propriétaires comprend le souverain, les possesseurs des terres et les décimateurs. Cette classe subsiste par le revenu ou produit net de la culture, qui lui est payé annuellement par la classe productive, après que celle-ci a prélevé, sur la reproduction qu'elle fait renaître annuellement, les richesses nécessaires pour se rembourser de ses avances annuelles et pour entretenir ses richesses d'exploitation.
La classe stérile est formée de tous les citoyens occupés à d'autres services et à d'autres travaux que ceux de l'agriculture, et dont les dépenses sont payées par la classe productive et par la classe des propriétaires, qui eux-mêmes tirent leurs revenus de la classe productive.
Pour suivre et calculer clairement les rapports de ces différentes classes entre elles, il faut se fixer à un cas quelconque, car on ne peut établir un calcul positif sur de simples abstractions.
Supposons donc un grand royaume dont le territoire porté à son plus haut degré d'agriculture, rapporterait tous les ans une reproduction de la valeur de cinq milliards, et où l'état permanent de cette valeur serait établi sur les prix constants qui ont cours entre les nations commerçantes, dans le cas où il y a constamment une libre concurrence de commerce, et une entière sûreté de la propriété des richesses d'exploitation de l'agriculture (1).
Le Tableau économique renferme les trois classes et leurs richesses annuelles, et décrit leur commerce dans la forme qui suit.
CLASSE CLASSE CLASSE
productive des propriétaires stérile
___ ___ ___
Avances Revenu Avances
annuelles de cette de deux milliards pour de cette classe
classe, montant à cette classe, il s'en de la somme d'un
deux milliards (2) dépense un milliard en milliard qui se
qui ont produit cinq achats à la classe dépense par la classe
milliards, productive et l'autre stérile en achats de
dont deux milliards milliard en achats à la matières premières à
sont en produit net classe stérile. la classe productive.
ou revenu.
Ainsi la classe productive vend pour un milliard de productions aux propriétaires du revenu, et pour un milliard à la classe stérile qui y achète les matières premières de ses ouvrages, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 milliards.
Le milliard que les propriétaires du revenu ont dépensé en achats à la classe stérile, est employé par cette classe pour la subsistance des agents dont elle est composée, en achats de productions prises à la classe productive, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 milliard.
Total des achats faits par les propriétaires du revenu et par la classe stérile à la classe productive, ci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 milliards.
De ces trois milliards reçus par la classe productive pour trois milliards de productions qu'elle a vendues, elle en doit deux milliards aux propriétaires pour l'année courante du revenu, et elle en dépense un milliard en achats d'ouvrages pris à la classe stérile. Cette dernière classe retient cette somme pour le remplacement de ses avances, qui ont été dépensées d'abord à la classe productive en achats de matières premières qu'elle a employées dans ses ouvrages. Ainsi ses avances ne produisent rien; elle les dépense, elles lui sont rendues, et restent toujours en réserve d'année en année.
Les matières premières et le travail pour les ouvrages montent les ventes de la classe stérile à deux milliards, donc un milliard est dépensé pour la subsistance des agents qui composent cette classe; et l'on voit qu'il n'y a là que consommation ou anéantissement de productions et point de reproduction; car cette classe ne subsiste que du payement successif de la rétribution due à son travail, qui est inséparable d'une dépense employée en subsistances, c'est-à-dire, en dépenses de pure consommation, sans régénération de ce qui s'anéantit par cette dépense stérile, qui est prise en entier sur la reproduction annuelle du territoire. L'autre milliard est réservé pour le remplacement de ses avances, qui, l'année suivante seront employées de nouveau à la classe productive en achats de matières premières pour les ouvrages que la classe stérile fabrique.
Ainsi les trois milliards que la classe productive a reçu(s) pour les ventes qu'elle a faites aux propriétaires du revenu et à la classe stérile, sont employés par la classe productive au payement du revenu de l'année courante de deux milliards et en achats d'un milliard d'ouvrages qu'elle paye à la classe stérile.
La marche de ce commerce entre les différentes classes, et ses conditions essentielles ne sont point hypothétiques. Quiconque voudra réfléchir, verra qu'elles sont fidèlement copiées d'après la nature : mais les données dont on s'est servi, et l'on en a prévenu, ne sont applicables qu'au cas dont il s'agit ici.
Les divers états de prospérité ou de dépérissement d'une nation agricole offrent une multitude d'autres cas et par conséquent d'autres données, dont chacune est le fondement d'un calcul particulier qui lui est propre en toute rigueur.
Celles d'où nous sommes partis fixent, d'après la règle la plus constante dans l'ordre naturel, à cinq milliards la reproduction totale que la classe productive fait renaître annuellement avec deux milliards d'avances annuelles sur un territoire tel que celui que nous avons décrit. Selon cette hypothèse, les avances annuelles reproduisent deux cent cinquante pour cent. Le revenu des propriétaires peut être alors égal aux avances annuelles. Mais ces données ont des conditions sine quabus non, elles supposent que la liberté du commerce soutient le débit des productions à un bon prix, par exemple, le prix du blé à 18 livres le setier; elles supposent d'ailleurs que le cultivateur n'ait à payer directement ou indirectement d'autres charges que le revenu : dont une partie, par exemple, les deux septièmes, doit former le revenu du souverain. Selon ces données sur un revenu total de deux milliards, la part du souverain serait de 572 millions (3); celle des propriétaires serait de quatre septièmes ou un milliard 144 millions; celle des décimateurs d'un septième ou 286 millions, l'impôt compris. Il n'y a aucune manière d'établir l'impôt qui puisse fournir un aussi grand revenu public, sans causer aucun dépérissement dans la reproduction annuelle de la nation (4).
Les propriétaires, le souverain et toute la nation ont un grand intérêt que l'impôt soit établi en entier sur le revenu des terres immédiatement; car toute autre forme d'imposition serait contre l'ordre naturel, parce qu'elle serait préjudiciable à la reproduction et à l'impôt, et que l'impôt retomberait sur l'impôt même. Tout est assujetti ici-bas aux lois de la nature : les hommes sont doués de l'intelligence nécessaire pour les connaître et les observer; mais la multiplicité des objets exige de grandes combinaisons qui forment le fond d'une science évidente fort étendue, dont l'étude est indispensable pour éviter les méprises dans la pratique.
Des cinq milliards de reproduction totale, les propriétaires du revenu et la classe stérile en ont acheté pour trois milliards pour leur consommation; ainsi il reste encore à la classe productive pour deux milliards de productions; cette classe a acheté en outre pour un milliard d'ouvrages à la classe stérile, ce qui lui fait un fonds annuel de trois milliards, lequel est consommé par les divers agents occupés, aux différents travaux de cette classe qui sont payés par les avances annuelles de la culture, et aux diverses réparations journalières du fonds de l'établissement qui sont payées par les intérêts dont on va parler.
Ainsi la dépense annuelle de la classe productive est de trois milliards, savoir deux milliards de productions qu'elle retient pour sa consommation, et un milliard d'ouvrages qu'elle a achetés à la classe stérile.
Ces trois milliards forment ce qu'on appelle LES REPRISES de la classe productive dont deux milliards constituent les avances annuelles qui se consomment pour le travail direct de la reproduction des cinq milliards que cette classe fait renaître annuellement pour restituer et perpétuer les dépenses qui s'anéantissent par la consommation; l'autre milliard est prélevé par cette même classe sur ses ventes pour les intérêts des avances de son établissement. On va faire sentir la nécessité de ces intérêts.
1° Le fonds des richesses d'exploitation qui constitue les avances primitives est sujet à un dépérissement journalier qui exige des réparations continuelles, indispensablement nécessaires pour que ce fonds important reste dans le même état, et ne marche pas progressivement vers un anéantissement total qui détruirait la culture et par conséquent la reproduction, et par conséquent les richesses de l'État, et par conséquent aussi la population.
2° La culture est inséparable de plusieurs grands accidents qui détruisent quelquefois presqu'entièrement la récolte; telles sont la gelée, la grêle, la nielle, les inondations, la mortalité des bestiaux, etc., etc. Si les cultivateurs n'avaient aucun fonds en réserve, il s'ensuivrait qu'après de tels accidents ils ne pourraient pas payer les propriétaires et le souverain, ou qu'ils ne pourraient pas subvenir aux dépenses de leur culture l'année suivante; ce dernier cas serait celui qui arriverait toujours attendu que le souverain et les propriétaires ont l'autorité pour se faire payer; et l'on sent les conséquences funestes d'un pareil anéantissement de culture qui retomberait bientôt et sans ressource sur les propriétaires sur le souverain, sur les décimateurs, sur tout le reste de la nation.
Les intérêts des avances de l'établissement des cultivateurs doivent donc être compris dans leurs reprises annuelles. Ils servent à faire face à ces grands accidents et à l'entretien journalier des richesses d'exploitation qui demandent à être réparées sans cesse.
On a remarqué plus haut (note 1) que les avances primitives étaient d'environ cinq fois plus forte que les avances annuelles; dans l'hypothèse actuelle où les avances annuelles sont de deux milliards, les avances primitives sont donc de dix milliards, les intérêts annuels d'un milliard ne sont que sur le pied de dix pour cent. Si l'on considère la quantité de dépenses auxquels ils doivent subvenir; si l'on songe à l'importance de leur destination; si l'on réfléchit que sans eux le payement des fermages et de l'impôt ne serait jamais assuré, que la régénération des dépenses de la société s'éteindrait, que le fonds de richesses d'exploitation et par conséquent, la culture disparaîtraient, que cette dévastation anéantirait la plus grande partie du genre humain, et renverrait l'autre vivre dans les forêts; on sentira qu'il s'en faut beaucoup que le taux de dix pour cent pour les intérêts des avances périssables de la culture soit un taux trop fort.
Nous ne disons pas que tous les cultivateurs retirent annuellement, outre leurs avances annuelles, dix pour cent, pour les intérêts de leurs avances primitives; mais nous disons que telle est une des principales conditions d'un état de prospérité; que toutes les fois que cela n'est pas ainsi chez une nation, cette nation est dans le dépérissement, et dans un dépérissement progressif d'année en année, tel que, lorsque sa marche est connue, on peut annoncer par le calcul le moment de l'entière destruction. Nous disons d'ailleurs qu'un fonds placé aussi avantageusement pour la nation que celui des avances de sa culture doit par lui-même rapporter net aux fermiers qui y joignent leurs travaux et l'emploi de leur intelligence, un intérêt annuel au moins aussi fort que celui que l'on paye aux rentiers fainéants.
La somme totale de ces intérêts se dépense annuellement, parce que les cultivateurs ne les laissent point oisifs; car dans les intervalles où ils ne sont pas obligés de les employer aux réparations' ils ne manquent pas de les mettre à profit pour accroître et améliorer leur culture sans quoi ils ne pourraient pas subvenir aux grands accidents. Voilà pourquoi on compte les intérêts dans la somme des dépenses annuelles.
RÉSUMÉ
Le total des cinq milliards partagé d'abord entre la classe productive et la classe des propriétaires, étant dépensé annuellement dans un ordre régulier qui assure perpétuellement la même reproduction annuelle il y a un milliard qui est dépensé par les propriétaires en achats faits à la classe productive, et un milliard en achats faits à la classe stérile, la classe productive qui vend pour trois milliards de productions aux deux autres classes en rend deux milliards pour le payement du revenu et en dépense un milliard en achats qu'elle fait à la classe stérile; ainsi la classe stérile reçoit deux milliards qu'elle emploie à la classe productive en achats pour la subsistance de ses agents et pour les matières premières de ses ouvrages; et la classe productive dépense elle-même annuellement pour deux milliards de productions, ce qui complète la dépense ou la consommation totale des cinq milliards de reproduction annuelle.
Tel est l'ordre régulier de la distribution de la dépense des cinq milliards que la classe productive fait renaître annuellement par la dépense de deux milliards d'avances annuelles, comprises dans la dépense totale des cinq milliards de reproduction annuelle.
On va présentement offrir aux yeux du lecteur la formule arithmétique de la distribution de cette dépense.
A la droite en tête, est la somme des avances de la classe productive, qui ont été dépensées l'année précédente, pour faire naître la récolte de l'année actuelle. Au-dessous de cette somme est une ligne qui la sépare de la colonne des sommes que reçoit cette classe.
A la gauche, sont les sommes que reçoit la classe stérile .
Au milieu, en tête, est la somme du revenu qui se partage à droite et à gauche, aux deux classes , où elle est dépensée.
Le partage de dépense est marqué par des lignes ponctuées qui partent de la somme du revenu et vont en descendant obliquement à l'une et à l'autre classe. Au bout de ces lignes est de part et d'autre la somme que les propriétaires du revenu dépensent en achats à chacune des ces classes.
Le commerce réciproque entre les deux classes est marqué aussi par des lignes ponctuées qui vont en descendant obliquement de l'une à l'autre classe où se font les achats; et au bout de chaque ligne est la somme que l'une des deux classes reçoit de l'autre ainsi réciproquement par le commerce qu'elles exercent entre elles pour leurs dépenses (5) . Enfin, le calcul se termine de chaque côté par la somme totale de la recette de chacune des deux classes. Et l'on voit que dans le cas donné, lorsque la distribution des dépenses suit l'ordre que l'on a décrit et détaillé ci-devant, la recette de la classe productive, en y comprenant les avances, est égale à la totalité de la reproduction annuelle, et que la culture, les richesses, la population restent dans le même état, sans accroît ni dépérissement. Un cas différent donnerait, comme on l'a dit plus haut, un résultat différent.
FORMULE DU TABLEAU ÉCONOMIQUE
Reproduction totale : Cinq milliards
Si les propriétaires dépensaient plus à la classe productive qu'à la classe stérile, pour améliorer leurs terres et accroître leurs revenus, ce surcroît de dépenses employé aux travaux de la classe productive devrait être regardé comme une addition aux avances de cette classe.
La dépense du revenu est supposée ici, dans l'état de prospérité' se distribuer également entre la classe productive et la classe stérile, au lieu que la classe productive ne porte qu'un tiers de sa dépense à la classe stérile; parce que les dépenses du cultivateur sont moins disponibles que celles du propriétaire; mais plus l'agriculture languit, plus alors on doit lui consacrer en partie les dépenses disponibles pour la rétablir.
OBSERVATIONS IMPORTANTES
PREMIÈRE OBSERVATION
On ne doit pas confondre les dépenses faites par les propriétaires à la classe stérile, et qui servent à la subsistance de cette classe, avec celles que les propriétaires font directement à la classe productive par eux-mêmes, par leurs commensaux et par les animaux qu'ils nourrissent; car ces dépenses que font les propriétaires à la classe productive peuvent être plus profitables à l'agriculture que celles qu'ils font à la classe stérile.
Parmi les propriétaires du revenu, il y en a un grand nombre qui sont fort riches et qui consomment les productions du plus haut prix; ainsi la masse de productions qu'ils consomment est en proportion beaucoup moins considérable que celle qui se consomme dans les autres classes à plus bas prix. Les hommes qui dépensent le revenu et qui achètent si chèrement, doivent donc être aussi à proportion beaucoup moins nombreux comparativement à la somme de leurs achats. Mais leurs dépenses soutiennent le prix des productions de la meilleure qualité, ce qui entretient par gradation le bon prix des autres productions, à l'avantage des revenus du territoire.
Il n'en est pas de même des grandes dépenses que les propriétaires peuvent faire à la classe stérile; et c'est ce qui constitue la différence du faste de subsistance et du luxe de décoration. Les effets du premier ne sont pas à craindre comme ceux de l'autre.
Celui qui achète un litron de petits pois 100 livres les paye à un cultivateur qui les emploie en dépenses de culture à l'avantage de la reproduction annuelle. Celui qui achète un galon d'or 100 livres le paye à un ouvrier qui en emploie une partie à racheter chez l'étranger la matière première; il n'y a que l'autre partie employée en achats pour sa subsistance, qui retourne à la classe productive, et ce retour même n'est pas aussi avantageux que l'aurait été la dépense directe du propriétaire à la classe productive; car l'ouvrier n'achète pas pour sa subsistance des productions de haut prix et ne contribue donc pas, ainsi que fait le propriétaire, à entretenir la valeur et les revenus des bonnes terres qui ont la propriété de produire des denrées précieuses. Quant à ce qui a passé en achats chez l'étranger, s'il revient à la classe productive, comme cela arrive en effet, du moins en partie chez les nations où il y a réciprocité de commerce de productions (6) c'est toujours avec la charge des frais de commerce qui y causent une diminution, et empêchent ce retour d'être complet.
DEUXIÈME OBSERVATION
Les dépenses de simple consommation sont des dépenses qui s'anéantissent elles-mêmes sans retour; elles ne peuvent être entretenues que par la classe productive, qui, quant à elle, peut se suffire à elle-même, ainsi elles doivent, quand elles ne sont pas employées à la reproduction, être regardées comme des dépenses stériles et même comme nuisibles, ou comme dépenses de luxe, si elles sont superflues et préjudiciables à l'agriculture.
La plus grande partie des dépenses des propriétaires sont au moins des dépenses stériles; on n'en peut excepter que celles qu'ils font pour la conservation et l'amélioration de leurs biens et pour en accroître la culture. Mais comme ils sont de droit naturel chargés des soins de la régie et des dépenses pour les réparations, de leur patrimoine, ils ne peuvent pas être confondus avec la partie de la population qui forme la classe purement stérile.
TROISIÈME OBSERVATION
Dans l'état de prospérité d'un royaume dont le territoire serait porté à son plus haut degré possible de culture, de liberté et de facilité de commerce, et où par conséquent le revenu des propriétaires ne pourrait plus s'accroître ceux-ci pourraient en dépenser la moitié en achats à la classe stérile. Mais si le territoire n'était pas complètement cultivé et amélioré si les chemins manquaient, s'il y avait des rivières à rendre navigables et des canaux à former pour le voiturage des productions, ils devraient s'épargner sur leurs dépenses à la classe stérile, pour accroître par les dépenses nécessaires leurs revenus et leurs jouissances autant qu'il serait possible. Jusqu'à ce qu'ils y fussent parvenus, leurs dépenses superflues à la classe stérile seraient des dépenses de luxe, préjudiciables à leur opulence et à la prospérité de la nation; car tout ce qui est désavantageux à l'agriculture est préjudiciable à la nation et à l'État, et tout ce qui favorise l'agriculture est profitable à l'État et à la nation. C'est la nécessité des dépenses que les propriétaires seuls peuvent faire pour l'accroissement de leurs richesses et pour le bien général de la société, qui fait que la sûreté de la propriété foncière est une condition essentielle de l'ordre naturel du gouvernement des empires.
La politique féodale a jadis envisagé cette propriété foncière comme fondement de la force militaire des seigneurs, mais elle n'a songé qu'à la propriété du terrain; de là tant de coutumes et tant de lois bizarres dans l'ordre des successions des biens fonds, qui subsistent encore malgré les changements arrivés dans la monarchie, tandis qu'on a été si peu attentif à la sûreté de la propriété des richesses mobilières nécessaires pour la culture qui peut seule faire valoir les biens fonds. On n'a pas assez vu que le véritable fondement de la force militaire d'un royaume est la prospérité même de la nation.
Rome a su vaincre et subjuguer beaucoup de nations, mais elle n'a pas su gouverner. Elle a spolié les richesses de l'agriculture des pays soumis à sa domination; dès lors sa force militaire a disparu, ses conquêtes qui l'avaient enrichie lui ont été enlevées; et elle s'est trouvée livrée à elle-même sans défense au pillage et aux violences de l'ennemi.
Dans l'ordre régulier que nous suivons ici, toute la somme des achats qui se font annuellement par les propriétaires et par la classe stérile revient annuellement à la classe productive, pour payer chaque année aux propriétaires le revenu de deux milliards, et pour lui payer à elle-même les intérêts de ses avances primitives et annuelles.
On ne pourrait rien soustraire à cette distribution de dépenses au désavantage de l'agriculture, ni rien soustraire des reprises du cultivateur, par quelque exaction ou par quelques entraves dans le commerce, qu'il n'arrivât du dépérissement dans la reproduction annuelle des richesses de la nation et une diminution de population facile à démontrer par le calcul. Ainsi c'est par l'ordre de la distribution des dépenses, selon qu'elles reviennent ou qu'elles sont soustraites à la classe productive, selon qu'elles augmentent ses avances, ou qu'elles les diminuent selon qu'elles soutiennent ou qu'elles font baisser le prix des productions, qu'on peut calculer les effets de la bonne ou mauvaise conduite d'une nation.
La classe stérile ne peut dépenser pour la subsistance de ses agents qu'environ la moitié des deux milliards qu'elle reçoit, parce que l'autre moitié est employée en achats de matières premières pour ses ouvrages. Ainsi cette classe ne forme qu'environ un quart de la nation.
Nous avons observé que sur les reprises de trois milliards de la classe productive, il y en a un milliard pour les intérêts des avances primitives et annuelles de cette classe, lequel est employé continuellement à la réparation de ces avances, ainsi il ne reste à cette classe qu'environ deux milliards pour la dépense de ses propres agents immédiats, qui par conséquent sont environ le double de ceux que la classe stérile, mais chacun avec l'aide des animaux de travail, y fait naître une reproduction qui peut faire subsister huit hommes, c'est-à-dire sa famille, qui peut être supposée de quatre personnes et une autre famille de pareil nombre de personnes appartenant à la classe stérile ou à la classe des propriétaires.
Si on veut entrer dans un examen plus détaillé de la distribution des dépenses d'une nation, on le trouvera dans la Philosophie rurale chap. 7. On y verra que outre les cinq milliards qui forment ici la portion de la nation, il y a d'autres dépenses : tels sont les frais de commerce et la nourriture des animaux de travail employés à la culture. Ces dépenses ne sont pas comprises dans la distribution des dépenses représentées dans le tableau, et étant ajoutées à celles-ci elles font monter la valeur totale de la reproduction annuelle à six milliards trois cent soixante dix millions. Mais il est à remarquer à cet égard que les frais du commerce peuvent augmenter au désavantage ou diminuer au profit de la nation, selon que cette partie est ou n'est pas dirigée contradictoirement à l'ordre naturel.
CINQUIÈME OBSERVATION
On a supposé dans l'état des dépenses que l'on vient d'exposer, que la nation ne commerce que sur elle-même; or, il n'y a point de royaume dont le territoire produise toutes les richesses propres à la jouissance de ses habitants; de sorte qu'il faut un commerce extérieur, par lequel une nation vend à l'étranger une partie de ses productions pour acheter de l'étranger celles dont elle a besoin. Cependant, comme elle ne peut acheter de l'étranger qu'autant qu'elle vend à l'étranger, l'état de ses dépenses doit toujours être conforme à la reproduction qui renaît annuellement de son territoire.
Les calculs de ces dépenses peuvent clone être régulièrement établis sur la quotité de cette reproduction même, abstraction faite de tout commerce extérieur dont les détails sont indéterminés, incalculables et inutiles à rechercher, il suffit de faire attention que dans l'état d'une libre concurrence de commerce extérieur, il n'y a qu'échange de valeur pour valeur égale, sans perte ni gain de part ou d'autre.
Quant aux frais de voiturage, la nation et l'étranger les payent de part et d'autre dans leurs ventes ou dans leurs achats; et ils forment pour les commerçants un fonds séparé de celui de la nation; parce que dans le commerce extérieur des nations agricoles, tout négociant est étranger relativement aux intérêts de ces nations. Ainsi un royaume agricole et commerçant réunit deux nations distinctes l'une de l'autre : l'une forme la partie constitutive de la société attachée au territoire, qui fournit le revenu, et l'autre est une addition extrinsèque qui fait partie de la république générale du commerce extérieur, employée et défrayée par les nations agricoles. Les frais de ce commerce, quoique nécessaires, doivent être regardés comme une dépense onéreuse, prélevée sur le revenu des propriétaires des terres; ainsi ils doivent être dégagés de tout monopole et de toutes surcharges qui retomberaient désastreusement sur les revenus des souverains et des autres propriétaires.
Dans l'état de libre concurrence de commerce extérieur, les prix qui ont cours entre les nations commerçantes, doivent être la base du calcul des richesses et des dépenses annuelles des nations qui ont un commerce facile et immune (7). Le commerce extérieur est plus ou moins étendu selon la diversité des consommations des habitants, et selon que les productions du pays sont plus ou moins variées. Plus les productions d'un royaume sont variées, moins il y a d'exportations et d'importations, et plus la nation épargne sur les frais du commerce extérieur qui cependant doit être toujours fort libre, débarrassé de toutes gênes et exempt de toutes impositions, parce que ce n'est que par la communication qu'il entretient entre les nations, qu'on peut s'assurer constamment dans le commerce intérieur le meilleur prix possible des productions du territoire, et le plus grand revenu possible pour le souverain et pour la nation.
SIXIÈME OBSERVATION
On peut voir les mêmes productions passer plusieurs fois par les mains des marchands et des artisans; mais il faut faire attention que ces répétitions de ventes et d'achats qui multiplient infructueusement la circulation ne sont que transposition de marchandises, et augmentation de frais, sans production de richesses. Le compte des productions se réduit clone à leur quantité et aux prix de leurs ventes de la première main.
Plus ces prix sont assujettis à l'ordre naturel, et plus ils sont constamment hauts, plus aussi ils sont profitables dans les échanges que l'on fait avec l'étranger, plus ils animent l'agriculture (8), plus ils soutiennent la valeur des différentes productions du territoire, plus ils accroissent les revenus du souverain et des propriétaires, plus aussi ils augmentent le numéraire de la nation et la masse des salaires payés pour la rétribution due au travail ou à l'emploi de ceux qui ne sont pas possesseurs primitifs des productions.
L'emploi de ces salaires bien ou mal distribués, contribue beaucoup à la prospérité ou à la dégradation d'un royaume, à la régularité ou au dérèglement des moeurs d'une nation et à l'accroissement ou à la diminution de la population. Les hommes peuvent être obsédés dans les campagnes et attirés par le luxe et la volupté dans la capitale, ou bien ils peuvent être également répandus dans les provinces. Dans ce dernier cas ils peuvent entretenir la consommation proche de la production; au lieu que dans l'autre cas, ils ne peuvent éviter les grandes dépenses de charrois qui font tomber les productions à bas prix dans les ventes de la première main et font décroître les revenus du territoire la masse des salaires et la population.
Le commerce de revendeur peut s'étendre selon l'activité et les facultés des commerçants; mais celui d'une nation agricole est réglé par la reproduction annuelle de son territoire. Les profits en pur bénéfice des commerçants régnicoles ne doivent clone point se confondre avec les richesses de la nation; puisque celles-ci ne peuvent s'étendre annuellement au-delà du débit de la reproduction annuelle de son territoire assujettie aux prix courants des ventes de la première main. Le commerçant tend à acheter au plus bas prix et à revendre au plus haut prix possible, afin d'étendre son bénéfice le plus qu'il est possible aux dépens de la nation : son intérêt particulier et l'intérêt de la nation sont opposés. Ce n'est pas cependant que le corps entier des commerçants, et même que chaque membre de ce corps immense n'ait, en regardant la chose en grand et dans sa véritable étendue un intérêt très réel à ce que les productions soient constamment vendues à la première main le plus haut prix qu'il est possible; car plus elles sont vendues à haut prix et plus la culture donne de produit net; plus la culture donne de produit net, et plus elle est profitable; plus la culture est profitable et plus elle s'étend de toutes parts, plus elle fait renaître de production, plus elle fournit de reprises pour les cultivateurs, de revenu pour le souverain, pour les propriétaires, pour les décimateurs, et de salaires pour tous les autres ordres de citoyens, plus les dépenses de toute espèce se multiplient plus le commerce acquiert d'objets, d'occasions et d'activité, et par conséquent plus la somme totale de gains des commerçants augmente par l'effet même de la concurrence, qui, dans chaque circonstance particulière empêche ces gains d'être excessifs au préjudice des prix des productions. Mais il y a bien peu de commerçants qui portent si loin leurs regards, et encore moins qui soient capables de sacrifier un gain présent à la certitude de ces grands avantages futurs. Aussi ne sont-ce point les commerçants, mais les besoins des consommateurs et les moyens qu'ils ont d'y satisfaire qui assurent primitivement les prix des productions à la vente de la première main. Les négociants ne font point naître les prix, ni la possibilité de commerce; mais c'est la possibilité du commerce et de la communication des prix qui fait naître les négociants (9).
SEPTIÈME OBSERVATION
Nous n'avons point parIé de la masse d'argent monnayé qui circule dans le commerce de chaque nation; et que le vulgaire regarde comme la vraie richesse des États, parce que avec de l'argent on peut acheter, dit-on, tout ce dont on a besoin; mais on ne se demande pas avec quoi on peut se procurer de l'argent; cependant cette richesse ne se donne pas pour rien, elle coûte autant qu'elle vaut à celui qui 1'acheta. C'est le commerce qui l'apporte aux nations qui n'ont pas de mines d'or ou d'argent, mais ces nations mêmes n'auraient ni or ni argent, si elles n'avaient pas de quoi les payer, et elles en auront toujours autant qu'elles voudront en acheter, ou qu'il leur conviendra d'en acheter, si elles ont des productions à donner en échange.
Je dis autant qu'il leur conviendra d'en acheter; car l'argent n'est pas la richesse dont les hommes ont besoin pour leur jouissance. Ce sont les biens nécessaires à la vie et à la reproduction annuelle de ces biens mêmes qu'il faut obtenir. Convertir des productions en argent pour soustraire cet argent aux dépenses profitables à l'agriculture, ce serait diminuer d'autant la reproduction annuelle des richesses. La masse d'argent ne peut accroître dans une nation qu'autant que cette reproduction elle-même s'y accroît, autrement l'accroissement de la masse d'argent ne pourrait se faire qu'au préjudice de la reproduction annuelle des richesses. Or le décroissement de cette reproduction entraînerait nécessairement, et bientôt, celui de la masse d'argent et l'appauvrissement de la nation; au lieu que la masse d'argent peut décroître dans une nation sans qu'il y ait décroissement des richesses chez cette nation, parce qu'on peut en bien des manières suppléer à l'argent quand on est riche et qu'on a un commerce facile et libre; mais rien ne peut suppléer, sans perte, au défaut de reproduction annuelle des richesses propres à la jouissance des hommes. On doit même présumer que le pécule d'une nation pauvre doit être à proportion plus considérable que celui d'une nation riche; car il ne leur en reste à l'une et à l'autre que la somme dont elles ont besoin pour leurs ventes et pour leurs achats. Or chez les nations pauvres on a beaucoup plus besoin de n'entremise de 1 argent dans le commerce; il faut y payer tout comptant, parce que l'on ne peut s'y fier à la promesse de presque personne. Mais chez les nations riches, il y a beaucoup d'hommes connus pour riches, et dont la promesse par écrit est regardée comme très sûre et bien garantie par leurs richesses, de sorte que toutes les ventes considérables s'y font à crédit, c'est-à-dire par l'entremise de papiers valables qui suppléent à l'argent et facilitent beaucoup le commerce. Ce n'est donc pas par le plus ou moins d'argent qu'on doit juger de l'opulence des États; aussi estime-t-on qu'un pécule égal au revenu des propriétaires des terres, est beaucoup plus que suffisant pour une nation agricole où la circulation se fait régulièrement, et où le commerce s'exerce avec confiance et une pleine liberté (10).
Quant à la république commerçante universelle répandue dans les différents pays, et quant aux petites nations purement commerçantes qui ne sont que des parties de cette république immense, et qui peuvent être regardées comme les villes capitales, ou, si l'on veut, comme les principaux comptoirs, la masse de leur argent monnayé est proportionnée à l'étendue de leur commerce de revente; elles augmentent cette masse autant qu'elles peuvent par leurs profits et par leur épargne, pour accroître le fonds de leur commerce; l'argent est leur propre patrimoine; les commerçants ne l'emploient dans leurs achats que pour le retirer avec bénéfice dans leurs ventes. Ils ne peuvent donc augmenter leur pécule qu'aux dépens des nations avec lesquelles ils commercent; il est toujours en réserve entre leurs mains; il ne sort de leurs comptoirs et ne circule que pour y revenir avec accroissement; ainsi cet argent ne peut faire partie des richesses des nations agricoles toujours bornées à leur reproduction, sur laquelle elles payent continuellement les gains des commerçants. Ceux-ci, en quelque pays que soit leur habitation, sont liés à différentes nations par leur commerce, c'est leur commerce même qui est leur patrie et le dépôt de leurs richesses; ils achètent et vendent où ils résident et où ils ne résident pas; l'étendue de l'exercice de la profession n'a point de limites déterminées et point de territoire particulier. Nos commerçants sont aussi les commerçants des autres nations; les commerçants des autres nations sont aussi nos commerçants; et les uns et les autres commercent aussi entre eux; ainsi la communication de leur commerce pénètre et s'étend partout, en visant toujours finalement vers l'argent, que le commerce lui-même apporte et distribue dans les nations conformément aux prix assujettis à l'ordre naturel qui règle journellement les valeurs vénales des productions. Mais les nations agricoles ont un autre point de vue, plus utile pour elles et plus étendu, elles ne doivent tendre qu'à la plus grande reproduction possible pour accroître et perpétuer les richesses propres à la jouissance des hommes; l'argent n'est pour elles qu'une petite richesse intermédiaire qui disparaîtrait en un moment sans la reproduction.
NOTES
(1) L'étendue du territoire serait d'environ 130 millions d'arpents de terres de différentes qualités; le fonds de richesses d'exploitation nécessaires pour tenir ce territoire en bonne valeur, serait d'environ douze milliards, et la population d'environ trente millions de personnes qui pourraient subsister avec aisance, conformément à leur état, du produit annuel de cinq milliards.
Mais il ne faut pas oublier que partout où la population jouit d'une vie paisible, elle s'accroît ordinairement au-delà du produit du territoire, aussi la force d'un État et le nombre des citoyens qui le composent, sont toujours assurés quand ils sont établis sur un fonds de richesses d'exploitation suffisant pour l'entretien d'une riche culture. La conservation de ce fonds de richesse d'exploitation doit être le principal objet du gouvernement économique; car les revenus du souverain et de la nation en dépendent entièrement, ainsi qu'il va être démontré par l'exposition de l'ordre régulier de la distribution des dépenses payées et entretenues par la reproduction annuelle.
(2) Les avances annuelles consistent dans les dépenses qui se font annuellement pour le travail de la culture; ces avances doivent être distinguées des avances primitives, qui forment le fond de l'établissement de la culture, et qui valent environ cinq fois plus que les avances annuelles.
(3) Il est à remarquer qu'on ne comprend point dans cette évaluation l'impôt qui se lève sur les dîmes affermées. En l'ajoutant à ce calcul, on verra que les deux-septièmes qui forment la part du souverain, lui donneraient sans dégradation environ 650 millions d'impôt annuel.
(4) S'il y avait des biens fonds exempts de la contribution de l'impôt ce ne devrait être qu'en considération de quelques avantages pour le bien de l'État, et alors cela devrait être compté comme faisant partie du revenu public; aussi de telles exemptions ne doivent avoir lieu qu'à bon titre.
(5) Chaque somme que reçoivent la classe productive et la classe stérile suppose une double valeur, parce qu'il y a vente et achat, et par conséquent la valeur de ce qui est vendu et la valeur de la somme qui paye l'achat; mais il n'y a de consommation réelle que pour la valeur des cinq milliards qui forment le total de la recette de la classe productive. Les sommes d'argent qui passent à chaque classe s'y distribuent par la circulation d'une somme totale d'argent qui recommence chaque année la même circulation. Cette somme d'argent peut être supposée plus ou moins grande dans sa totalité, et la circulation plus ou moins rapide; car la rapidité de la circulation de l'argent peut suppléer en grande partie à la quantité de la masse d'argent. Dans une année, par exemple, où, sans qu'il y eût de diminution dans la reproduction, il y aurait une grande augmentation du prix des productions, soit par des facilités données au commerce ou autrement; il ne serait pas nécessaire qu'il y eût augmentation de la masse pécuniaire pour le paiement des achats de ces productions. Cependant il passerait dans les mains des acheteurs et des vendeurs de plus grosses sommes d'argent qui feraient croire à la plupart que la masse d'argent monnayé serait fort augmentée dans le royaume. Aussi cette apparence équivalente à la réalité est-elle fort mystérieuse pour le vulgaire.
(6) Ce qui n'est pas ordinaire dans le commerce des Indes orientales; si ce n'est lorsqu'il se fait par des commerçants étrangers qui nous vendent ce qu'ils y ont acheté, et qui emploient chez nous, en achats de productions, l'argent même avec lequel nous avons payé leurs marchandises des Indes. Mais il n'en est pas de même lorsque ce commerce se fait par nos commerçants régnicoles, dont le trafic se borne entre nous et les Indiens orientaux qui ne veulent que de l'argent.
(7) C'est-à-dire exempt de toutes contributions fiscales, seigneuriales, etc., de monopoles, d'appointements d'inspecteurs et d'autres officiers inutiles. Le commerce, comme l'agriculture, ne doit avoir d'autre gouvernement que l'ordre naturel. Dans tout acte de commerce, il y a le vendeur et l'acheteur qui stipulent contradictoirement et librement leurs intérêts; et leurs intérêts ainsi réglés par eux-mêmes, qui en sont seuls juges compétents, se trouvent conformes à l'intérêt public; toute entremise d'officiers revêtus d'autorité, y est étrangère, et d'autant plus dangereuse qu'on y doit craindre l'ignorance et des motifs encore plus redoutables. Le monopole dans le commerce et dans l'agriculture n'a que trop souvent trouvé des protecteurs; la plantation des vignes, la vente des eaux-de-vie de cidre, la liberté du commerce des grains, l'entrée des marchandises de main-d'oeuvre étrangères, ont été prohibées; les manufactures du royaume ont obtenu des privilèges exclusifs au préjudice les unes des autres; on a contraint les entrepreneurs des manufactures à employer des matières premières étrangères à l'exclusion de celles du pays, etc.; de fausses lueurs ont brillé dans l'obscurité, et l'ordre naturel a été interverti par des intérêts particuliers toujours cachés et toujours sollicitant sous le voile du bien général.
(8) L'intérêt du cultivateur est le premier ressort de toutes les opérations économiques et de tous les succès de l'agriculture; plus les productions sont constamment à haut prix, plus le retour annuel des reprises des fermiers est assuré, plus la culture s'accroît, et plus les terres rapportent de revenu, tant par le bon prix des productions, que par l'augmentation de la reproduction annuelle; plus la reproduction s'accroît, plus les richesses de la nation se multiplient, et plus la puissance de l'État augmente.
(9) Il en est de ceux-ci comme de la corde d'un puits et de l'usage qu'on en fait qui ne sont point la source de l'eau qui est dans le puits; tandis qu'au contraire c'est l'eau qui est dans le puits, jointe à la connaissance et au besoin qu'on en a, qui est la cause de l'usage qu'on fait de la corde. Les hommes éclairés ne confondent pas les causes avec les moyens.
(10) On remarque que le pécule d'Angleterre reste fixé à peu près à cette proportion, qui, dans l'état présent de ses richesses, le soutient environ à 26 millions sterlings, ou à 11 millions de marcs d'argent. Cette richesse en argent ne doit pas en imposer dans un pays ou le commerce de revente et de voiturage domine, et où il faut distinguer le pécule des commerçants de celui de la nation. Ces deux parties n'ont rien de commun; si ce n'est qu'autant que les commerçants veulent bien vendre à intérêt leur argent à la nation qui a fondé ses forces militaires sur les emprunts, ce qui n'est pas une preuve de la puissance réelle d'un Etat. Si cette nation s'est trouvée exposée par ses guerres à des besoins pressants, à des emprunts excessifs, ce n'était pas par le défaut de l'argent, c'était par les dépenses qui excédaient le revenu public. Plus les emprunts suppléent aux revenus, plus les revenus se trouvent surchargés par les dettes; et la nation se ruinerait, si la source même des revenus en souffrait un dépérissement progressif, qui diminuât la reproduction, annuelle des richesses. C'est sous ce point de vue qu'il faut envisager l'état des nations, c'est car par les revenus du territoire qu'il faut juger de la prospérité et de la puissance réelle d'un empire. Le pécule est toujours renaissant dans une nation où les richesses se renouvellent continuellement et sans dépérissement.
Pendant près d'un siècle, c'est-à-dire, depuis 1444 jusqu'à 1525, il y a eu en Europe une grande diminution dans la quantité de l'argent comme on peut en juger par le prix des marchandises en ce temps-là; mais cette moindre quantité de pécule était indifférente aux nations, parce que la valeur vénale de cette richesse était la même partout, et que, par rapport à l'argent, leur état était le même relativement à leurs revenus qui étaient partout également mesurés par la valeur uniforme de l'argent. Dans ce cas, il vaut mieux, pour la commodité des hommes, que ce soit la valeur qui supplée à la masse, que si la masse suppléait à la valeur.
Il n'est pas douteux que la découverte de l'Amérique a procuré en Europe une plus grande abondance d'or et d'argent, cependant leur valeur avait commencé à baisser très sensiblement par rapport aux marchandises, avant l'arrivée de l'or et de l'argent de l'Amérique en Europe. Mais toutes ces variétés générales ne changent rien à l'état du pécule de chaque nation, qui se proportionne toujours aux revenus des biens-fonds, abstraction faite de celui qui fait partie du fonds du commerce extérieur des négociants, et qui circule entre les nations, comme celui d'une nation circule entre les provinces du même royaume
Le pécule de ces négociants circule aussi entre la métropole et ses colonies, ordinairement sans y accroître les richesses de part ni d'autre; quelque fois même en les diminuant beaucoup, surtout lorsqu'il y a exclusion de la concurrence des commerçants de tout pays.
Dans ce cas le monopole accroît le pécule des commerçants sur la métropole et sur les colonies et diminue celui des colonies et de leur métropole. Celle-ci néanmoins oublie que les négociants ne lui donnent pas leur argent pour rien, et qu'ils lui revendent au contraire toute sa valeur cet argent qu'ils ont gagné à ses dépens. Elle se laisse persuader que comme ses négociants sont nationaux, c'est elle-même qui profite du monopole qu'on exerce sur elle et sur ses colonies, et qui diminue leurs richesses et le prix des productions de son propre territoire. Ces idées perverses et absurdes ont causé depuis quelques siècles un grand désordre en Europe.
Dans le siècle précédent, sous Louis XIV, le marc d'argent monnayé valait 28 livres. Ainsi 18.600.000 marcs d'argent valaient alors environ 500 millions. C'était à peu près l'état du pécule de la France dans ce temps oit le royaume était beaucoup plus riche que sur la fin du règne de ce monarque.
En 1716, la refonte générale des espèces ne monta pas à 400 millions; le marc d'argent monnayé était à 43 livres 12 sols; ainsi la masse des espèces de cette refonte ne montait pas à neuf millions de marcs; c'était plus de moitié moins que dans les refontes générales de 1683 et 1693. Cette masse de pécule n'aura pu augmenter par les fabrications annuelles d'espèces, qu'autant que le revenu de la nation aura augmenté. Quelque considérable que soit le total de ces fabrications annuelles depuis cette refonte, il aura moins servi à augmenter la masse d'argent monnayé, qu'à réparer ce qui en est enlevé annuellement par la contrebande, par les diverses branches de commerce passif, et par d'autres emplois de l'argent chez l'étranger; car depuis cinquante ans, le total de ces transmissions annuelles bien calculé, se trouverait fort considérable. L'augmentation du numéraire qui est fixée depuis longtemps à 54 livres, ne prouve pas que la quantité du pécule de la nation ait beaucoup augmenté; puisqu'augmenter le numéraire c'est tâcher de suppléer à la réalité par la dénomination.
Ces observations, il est vrai, sont peu conformes aux opinions du vulgaire sur la quantité d'argent monnayé d'une nation. Le peuple croit que c'est dans l'argent que consiste la richesse d'un État; mais l'argent, comme toutes les autres productions, n'est richesse qu'à raison de sa valeur vénale, et n'est pas plus difficile à acquérir que toute autre marchandises, en le payant par d'autres richesses. Sa quantité dans un état y est bornée à son usage, qui, y est réglé par les ventes et les achats que fait la nation dans ses dépenses annuelles; et les dépenses annuelles de la nation sont réglées par les revenus. Une nation ne doit donc avoir d'argent monnayé qu'à raison de ses revenus; une plus grande quantité lui serait inutile; elle en échangerait le superflu avec les autres nations, pour d'autres richesses qui lui seraient plus avantageuses ou plus satisfaisantes; car les possesseurs de l'argent, même les plus économes, sont toujours attentifs à en retirer quelque profit. Si on trouve à le prêter dans le pays à un haut intérêt, c'est urne preuve qu'il n'y est tout au plus que dans la proportion que nous avons observée, puisqu'on en paye l'usage ou le besoin à si haut prix.